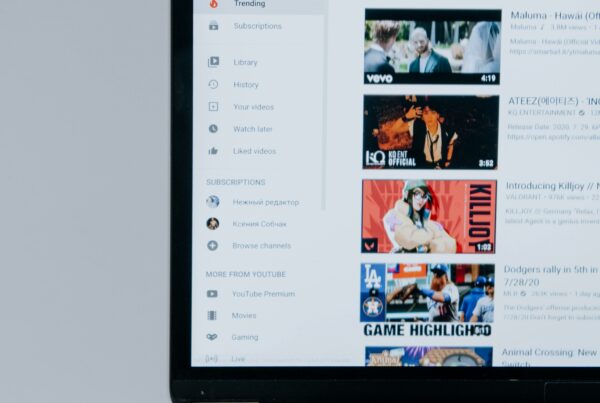Le paysage de l’industrie musicale américaine est en pleine mutation, marqué par des initiatives législatives visant à moderniser les mécanismes de rémunération des artistes à l’ère numérique. Parmi ces initiatives, le Music Fairness Act cherche à rebattre les cartes en matière de droits d’auteur et de diffusion musicale. Jetons un coup d’œil aux conséquences de ce projet de loi !
Contexte du projet
Ce n’est pas la première fois qu’une telle loi est proposée de l’autre côté de l’Atlantique, et pour cause, elle tente d’établir une rémunération plus équitable pour tous les acteur.rice.s de l’industrie musicale.
Petit point de contexte : actuellement, la loi américaine sur le copyright contraint les radios américaines AM/FM à ne rémunérer équitablement que les auteur.rice.s et compositeur.rice.s des titres diffusés sur leurs fréquences. Cela en fait une anomalie réglementaire par rapport à beaucoup d’autres pays du monde, dont ceux de l’Union Européenne. En Europe, les diffuseurs hertziens (radios et télévision), ainsi que les lieux sonorisés comme les bars, commerces, ou discothèques, sont dans l’obligation de payer des redevances d’exécution publiques aux labels et aux artistes (en plus des auteur.rice.s et compositeur.rice.s).
Les Etats-Unis ont fait le choix de limiter les rémunérations des artistes et producteur.rices à certaines utilisations, dont les radios AM/FM ne font pas partie. En dehors des problèmes évidents d’uniformité entre les pays et de non rémunération d’une partie des acteur.rice.s de l’industrie, cette décision crée une inégalité criante avec les webradios ou radio interactives, qui elles doivent s’acquitter de cette taxe.

Des répercussions pour l’hexagone
Ce conflit entre les radios hertziennes américaines et les détenteurs de droits voisins sur les enregistrements de musique a des répercussions jusqu’en Europe. Du fait de la non réciprocité du droit américain, de nombreuses sociétés de perception et de répartition étrangères, dont les sociétés françaises, ne reversent pas aux artistes et producteur.rice.s américains leur part des droits perçus au titre de la diffusion de leurs titres sur leur territoire national.
Ainsi si le Music Fairness Act est accepté dans la législation américaine, cela aura irrémédiablement des conséquences sur l’industrie musicale Française. En effet, actuellement, les sommes collectées et non réparties aux artistes et producteur.rice.s américains, sont considérées comme “non répartissables” et traditionnellement utilisées pour abonder les fonds d’aide à la création. En 2023, la coalition MusicFIRST estimait le manque à gagner des artistes et labels américains à 200 millions de dollars par an, ce qui équivaut à un peu plus de 16% des droits d’exécution publique collectés au titre de la rémunération équitable en France.
Le 8 septembre 2020, la Cour de justice européenne (CJUE), rendait une décision invalidant les réserves pour “non réciprocité” émises en matière de rémunération équitable à l’encontre des Etats-Unis par les sociétés civiles dans de nombreux pays européens dont la France, exigeant la répartition de ces sommes aux artistes et labels américains. Cette décision de la CJUE, dont l’application se veut rétroactive, menace de priver la filière phonographique française d’une source de financement essentielle. Dans le cas de la SPPF, elle devrait entraîner une diminution de près de 50% de son budget consacré aux aides, qui s’élevait en moyenne à 8 millions d’euros par an jusque-là. “Cette décision se traduit par une baisse de plus de 35 % des budgets consacrés à l’aide à la création et à l’emploi des artistes-interprètes en France”, a indiqué de son côté l’Adami, soit “entre 12 et 15 millions d’euros de pertes par an”.
Affaire à suivre donc !